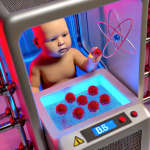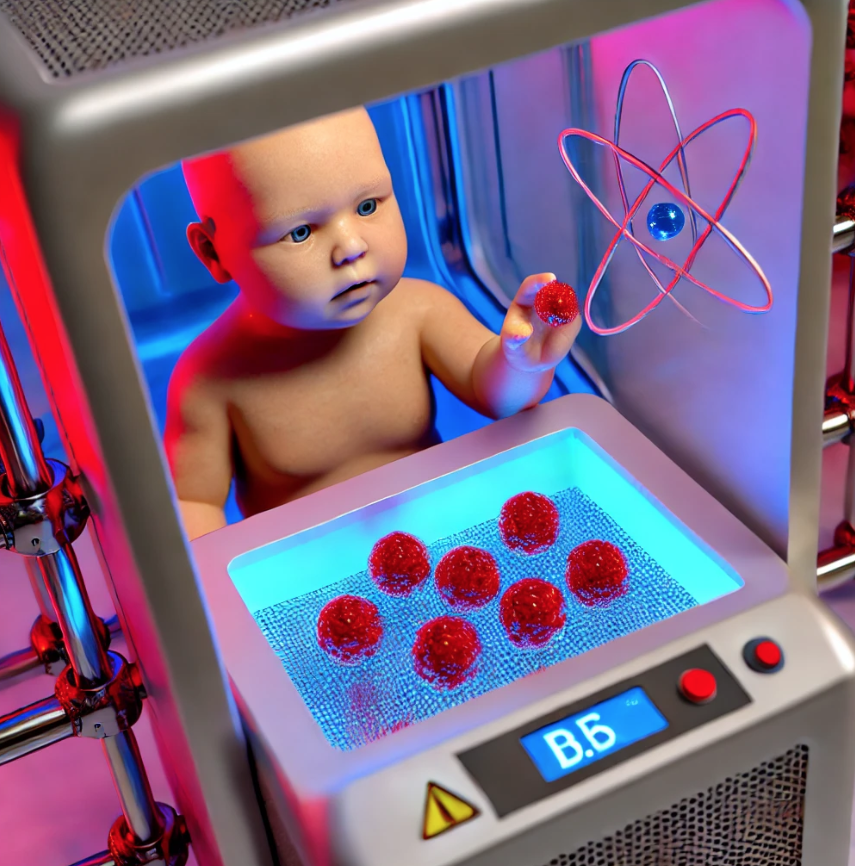Retour sur les tentatives des États-Unis pour mettre fin au conflit israélo-palestinien et instaurer la paix en partenariat avec l’Arabie Saoudite.
Depuis le 6 octobre 2023, le Moyen-Orient a été le théâtre d’intenses efforts diplomatiques menés par l’administration Biden. Cette année fut marquée par des négociations complexes, des confrontations militaires et de grands espoirs, souvent suivis par des échecs désespérants. Selon The Atlantic, les États-Unis ont tenté de mener à bien des discussions visant à stabiliser la région en s’appuyant sur une normalisation des relations entre Israël et l’Arabie Saoudite, mais ces efforts n’ont pas porté les fruits espérés.
Les débuts prometteurs qui ont rapidement viré au cauchemar
Au début d’octobre 2023, Brett McGurk, coordinateur de la Maison Blanche pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, croyait fermement qu’un accord de paix au Moyen-Orient était à portée de main. L’idée centrale consistait à promouvoir la création d’un État palestinien en échange de la normalisation des relations diplomatiques entre l’Arabie Saoudite et Israël, une solution perçue comme cruciale pour apaiser les tensions régionales.
Mais, comme le souligne l’article de The Atlantic, tout s’est rapidement effondré lorsque le Hamas a lancé une attaque contre Israël. En réponse, les États-Unis ont dû réagir en urgence, réaffirmant leur soutien total à Israël tout en cherchant à éviter une escalade régionale. L’objectif de Biden était de ramener la paix et de négocier la libération des 251 otages capturés par le Hamas. Mais la situation s’est aggravée lorsque le Hezbollah est entré en jeu, menaçant de déclencher une guerre depuis le Liban.
Les pressions diplomatiques et les retards dans l’action
Antony Blinken, secrétaire d’État américain, a joué un rôle de premier plan en essayant de maintenir un fragile équilibre diplomatique. Le 16 octobre, il revient en Israël après avoir rencontré des dirigeants arabes. Selon The Atlantic, Israël poursuivait ses bombardements sur Gaza, déstabilisant même ses voisins arabes les plus modérés. Blinken, dans ses discussions avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou, a insisté pour permettre l’entrée de l’aide humanitaire à Gaza, une demande qui a finalement été acceptée après de longues négociations.
Le 17 octobre, Joe Biden lui-même s’est rendu en Israël. En public, il a exprimé un soutien inébranlable à Israël, mais en privé, il a tenté de persuader Netanyahou de réduire les objectifs militaires. Résultat, l’armée israélienne a décidé d’envoyer une force plus restreinte pour éviter les centres urbains majeurs.
Pourtant, malgré des progrès apparents, les combats ont repris après seulement quelques jours de cessez-le-feu, tandis que la situation humanitaire à Gaza devenait critique. Des critiques ont même émergé au sein de l’administration américaine, certains reprochant à Biden son soutien inconditionnel à Israël, vu les pertes civiles engendrées.
Les efforts infructueux pour la normalisation des relations israélo-saoudiennes
Début janvier 2024, Antony Blinken s’est rendu en Arabie Saoudite pour tenter de remettre sur les rails les discussions de normalisation. Le prince héritier Mohammed ben Salmane (MBS) a insisté sur le fait que l’administration Biden était la meilleure chance pour parvenir à un accord. Mais le contexte de guerre à Gaza rendait toute avancée politique extrêmement difficile.
En avril, Israël a mené une frappe aérienne en Syrie, tuant plusieurs généraux iraniens, ce qui a failli déclencher une escalade majeure. Malgré cela, les États-Unis ont réussi à apaiser la situation. En mai, Joe Biden a proposé un plan de cessez-le-feu, mais les divisions au sein du gouvernement israélien ont rendu sa mise en œuvre difficile, rendant la paix plus insaisissable que jamais.
Une situation qui dégénère davantage
En août 2024, alors que les espoirs de cessez-le-feu étaient proches, un attentat a tué Ismail Haniyeh, chef de la branche politique du Hamas. Israël a revendiqué cet assassinat, provoquant de nouvelles tensions et des craintes de représailles de la part des groupes militants de la région. Malgré tout, les négociations pour la paix se sont poursuivies.
Après onze mois de diplomatie intense, l’article de The Atlantic conclut que les efforts de l’administration Biden ont échoué. Les souffrances persistent, les combats se poursuivent, et l’espoir de paix reste hors de portée.
Une année de diplomatie acharnée pour peu de résultats
L’article de The Atlantic nous rappelle combien la paix au Moyen-Orient est une quête ardue, faite d’efforts diplomatiques complexes et de réalités souvent brutales sur le terrain. L’administration Biden a tenté, à plusieurs reprises, d’influencer le cours des événements, mais les tensions historiques et les intérêts contradictoires ont rendu ces efforts extrêmement difficiles. À ce jour, la paix reste un objectif lointain, bien que chaque geste diplomatique contribue, malgré tout, à maintenir une lueur d’espoir.
Source : The Atlantic, article de Franklin Foer, 25 septembre 2024.