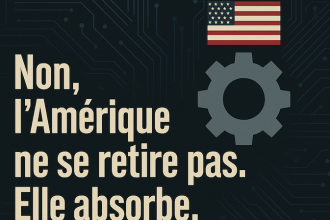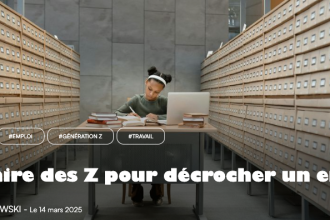La France dans l’OTAN en mode schizophrène

En 2009, Nicolas Sarkozy annonçait avec solennité le retour de la France dans le commandement militaire intégré de l’OTAN. Mais seize ans plus tard, un détail change tout : la dissuasion nucléaire française reste totalement autonome. Un choix historique, stratégique… et de plus en plus absurde.
L’OTAN a un cerveau. La France reste dehors.
Lorsque Sarkozy réintègre le commandement militaire intégré en 2009, il acte une rupture avec la doctrine gaullienne de retrait de 1966. La France revient dans le système de planification militaire allié, retrouve des postes clés au sein du SHAPE, et renoue officiellement avec les mécanismes opérationnels communs.
Mais le cœur stratégique de l’OTAN reste inaccessible : le Groupe des plans nucléaires (NPG), où se discutent la posture, la doctrine et les décisions collectives autour de la dissuasion atomique.
La France n’y participe pas. Par choix. Par fierté. Par mythe.
Le NPG : là où les vraies décisions se prennent
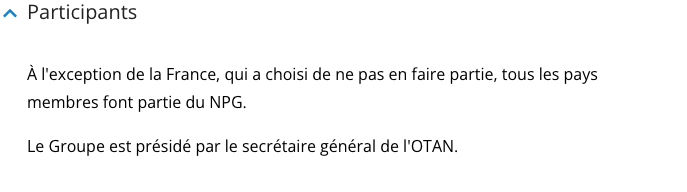
Le NPG n’est pas une formalité bureaucratique. C’est le lieu où se décide comment, quand, et contre qui la dissuasion nucléaire de l’Alliance peut être mobilisée.
C’est là que les États-Unis, le Royaume-Uni et les autres membres de l’OTAN harmonisent leur stratégie face à des puissances comme la Russie.
La France, puissance nucléaire à part entière, choisit de rester à l’écart.
L’arme nucléaire française est indépendante. Intransmissible. Intouchable.
Mais aussi incoordonnée.
Macron, le protecteur sans contrat
Depuis le début de la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron se positionne comme le garant de la sécurité européenne. Il multiplie les déclarations sur l’autonomie stratégique, la défense commune, l’Europe puissance.
Mais il refuse l’essentiel : la mutualisation stratégique.
À défaut de coordination, il parle de “réassurance”. Il déploie quelques troupes, organise des visites à Kiev, et suggère que la dissuasion française profiterait à toute l’Europe. Sans consultation. Sans mécanisme partagé. Sans engagement mutuel.
La réassurance sans intégration. La protection sans contrat. La promesse sans garantie.
L’illusion persistante de la souveraineté nucléaire
La France veut à la fois faire partie de l’Alliance et ne jamais lui devoir son feu nucléaire. Elle veut inspirer confiance à ses partenaires tout en gardant la clé sous son oreiller.
Elle invoque De Gaulle pour justifier un isolement qui, aujourd’hui, affaiblit l’Europe plus qu’il ne la protège.
Cette ambiguïté n’est plus une stratégie. C’est une posture.
Et elle repose sur une illusion : celle d’une souveraineté nucléaire capable à elle seule de dissuader une puissance comme la Russie, sans coordination ni effet d’annonce commun.
Ce que la RAND propose : une France qui assume
En mars 2025, un rapport de la RAND Corporation pose une hypothèse audacieuse :
Et si la France rejoignait enfin le NPG ?
Ce choix stratégique renforcerait l’unité de l’OTAN, enverrait un signal clair à Moscou, et créerait enfin une dissuasion réellement européenne.
Mais il suppose un renoncement symbolique : abandonner l’idée que l’indépendance stratégique passe par l’autarcie nucléaire.
Et surtout, briser un totem politique vieux de 60 ans.
Une Europe vulnérable, une France en équilibre instable
Tant que la France refuse d’intégrer le cœur décisionnel de l’Alliance, l’Europe conserve une faille dans sa cuirasse stratégique.
Tant que le pouvoir nucléaire reste solitaire, la dissuasion européenne reste incomplète.
Et tant que la France préfère les postures gaulliennes aux réalités contemporaines, elle n’est ni un vrai leader, ni un vrai partenaire.
Emmanuel Macron se présente en stratège. Mais il est seul à sa table de commandement.
Un chef de guerre en hologramme.
Un général sans alliance nucléaire.
Un protecteur sans clause mutuelle.