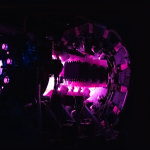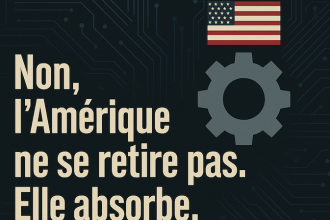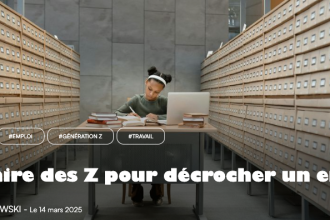Le 14 avril 2025, l’Union européenne a annoncé un plan d’aide de 1,6 milliard d’euros en faveur des Palestiniens. L’enveloppe, détaillée dans Le Figaro, comprend 620 millions d’euros de dons directs à l’Autorité palestinienne, 576 millions pour des projets de développement économique en Cisjordanie et à Gaza, et 400 millions de prêts via la Banque européenne d’investissement. Officiellement, cette aide est destinée à “préserver la stabilité” et à maintenir ouverte la possibilité d’une solution politique. Mais dans les faits, il s’agit d’un mécanisme de soutien administratif et budgétaire sans exigence politique sérieuse.
Dans un même temps, Emmanuel Macron a exprimé des positions successives sur la reconnaissance d’un État palestinien. En mai 2024, il affirmait qu’une telle décision ne se prendrait pas “sous le coup de l’émotion”. Le 10 avril 2025, dans Le Monde, il annonce qu’une reconnaissance pourrait avoir lieu en juin, dans le cadre d’une conférence internationale à New York. Puis, le 11 avril, dans L’Express, il rectifie en dénonçant des “fausses informations” et précise qu’aucune décision ne sera prise “en réaction à des violences”.
Ces annonces ne traduisent pas un positionnement politique. Elles visent à maintenir une posture diplomatique ouverte, tout en repoussant toute décision potentiellement coûteuse. La reconnaissance devient un instrument de timing, pas une conviction. Ce n’est pas la situation palestinienne qui dicte l’agenda français, mais l’opportunité internationale du moment.
Cette approche prudente rejoint la logique du rapport publié par la RAND Corporation début 2025. Ce document propose une vision technique du futur palestinien : corridors logistiques, infrastructures urbaines, projets énergétiques, connexion entre Gaza et la Cisjordanie. Mais à aucun moment, le rapport ne s’engage sur les réalités politiques. Il ne parle pas de gouvernance, ni de division institutionnelle, ni de rapports de force internes. Il organise le territoire sans se poser la question de qui le gouvernera, ni sur quelle base politique.
On retrouve ici un schéma bien connu en France : celui des politiques appliquées depuis 40 ans aux quartiers dits “sensibles”. On investit massivement dans des équipements, des services publics, des réhabilitations urbaines. On finance des associations, on construit des médiathèques, des stades, des maisons de quartier. Mais on évite le débat politique de fond. On évite de parler de pouvoir local, de responsabilité, de représentativité, de stratégie de long terme. Et lorsqu’une crise éclate, comme les émeutes de 2023 après la mort de Nahel, le réflexe reste le même : injecter de l’argent, calmer, mais ne rien affronter.
Dans le dossier palestinien, le même schéma se répète à l’échelle internationale. L’Europe finance pour éviter un effondrement. La France communique pour éviter une polarisation. Les États-Unis temporisent. Et pendant ce temps, la direction palestinienne ne présente aucun projet d’unification institutionnelle ni de réforme politique crédible. L’Autorité palestinienne est en perte de légitimité, le Hamas agit hors de tout cadre diplomatique, et les acteurs internationaux entretiennent ce statu quo en l’habillant d’un langage de développement.
Personne n’oblige la direction palestinienne à sortir de ses contradictions internes. Personne n’exige de plan stratégique unifié. Personne ne conditionne l’aide ou la reconnaissance à une transformation politique minimale. On finance pour maintenir l’ordre, pas pour favoriser un avenir.
Ce traitement infantilisant a les mêmes effets en Palestine qu’en banlieue : il produit de la dépendance, de la colère, du repli, et un discours victimaire déconnecté des responsabilités internes. On dénonce l’occupation, le manque de reconnaissance, l’abandon international — mais on ne produit ni unité politique ni projet souverain. Cette posture, entretenue depuis des années, ne crée pas les conditions d’un État. Elle pérennise un assistanat institutionnalisé.
Il est temps de le reconnaître : la solution ne viendra pas de l’extérieur. Ni l’Europe, ni la France, ni les pays arabes ne peuvent — ni ne doivent — créer un État palestinien à la place des Palestiniens. Ils peuvent accompagner. Ils peuvent soutenir. Mais sans interlocuteur structuré, sans direction politique claire, il n’y a rien à reconnaître, rien à construire, et aucun avenir à stabiliser.
Financer la stabilité n’est pas une politique. Reporter la reconnaissance n’est pas une stratégie. Organiser le territoire sans répondre à la question du pouvoir n’est pas une vision.
Et tant que ce modèle perdure, on continuera de financer une crise que personne n’assume de résoudre.